Temple de Venus:
En 2008, le PCB a mené une campagne de sondages sur un site emblématique du territoire, la villa romaine installée sur le promontoire qui domine au Nord l’étang de Vendres et qui est dite « Temple de Vénus » depuis le XVIIe siècle. Il s’agissait d’assurer des bases scientifiques pour une mise en tourisme. Le plan des vestiges, qui a pu être établi, a révélé l’ampleur du programme architectural mis en œuvre à l’époque romaine, dans le courant du Ier siècle de notre ère. Les résultats de ces recherches sont intégrés aux itinéraires culturels de découverte que crée le Parc.
Depuis 2017 le site est intégré dans un programme de restitution en 3D des vestiges archéologiques et des informations disponibles sur le domaine rural, qu’il a été possible d’envisager dans son fonctionnement antique et de replacer au sein du paysage romain. Cette recherche constitue la première étape du projet IDAN, Itinéraire de Découverte Archéologie et Nature, conduit avec l’association Patrimoine et Nature et soutenu par le Conseil départemental de l’Hérault, la Communauté de communes La Domitienne, les communes de Vendres et Lespignan et l’association Les Amis de Lespignan.
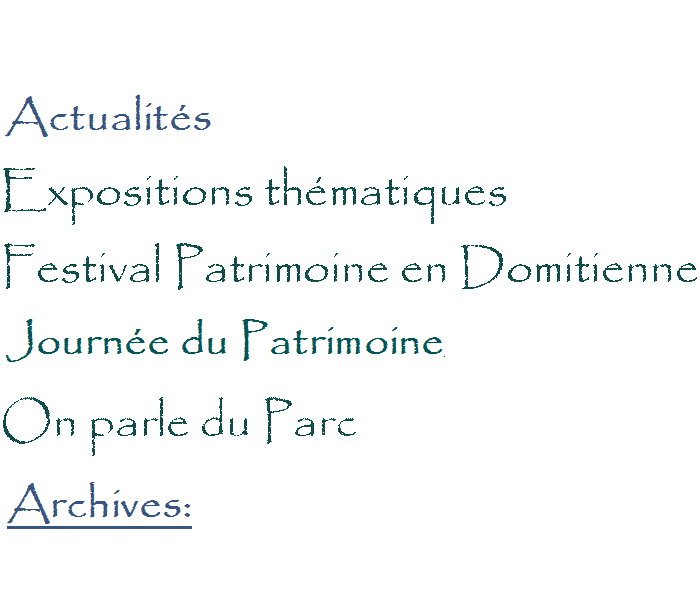
Recherches:
archéo-historiques
Accueil
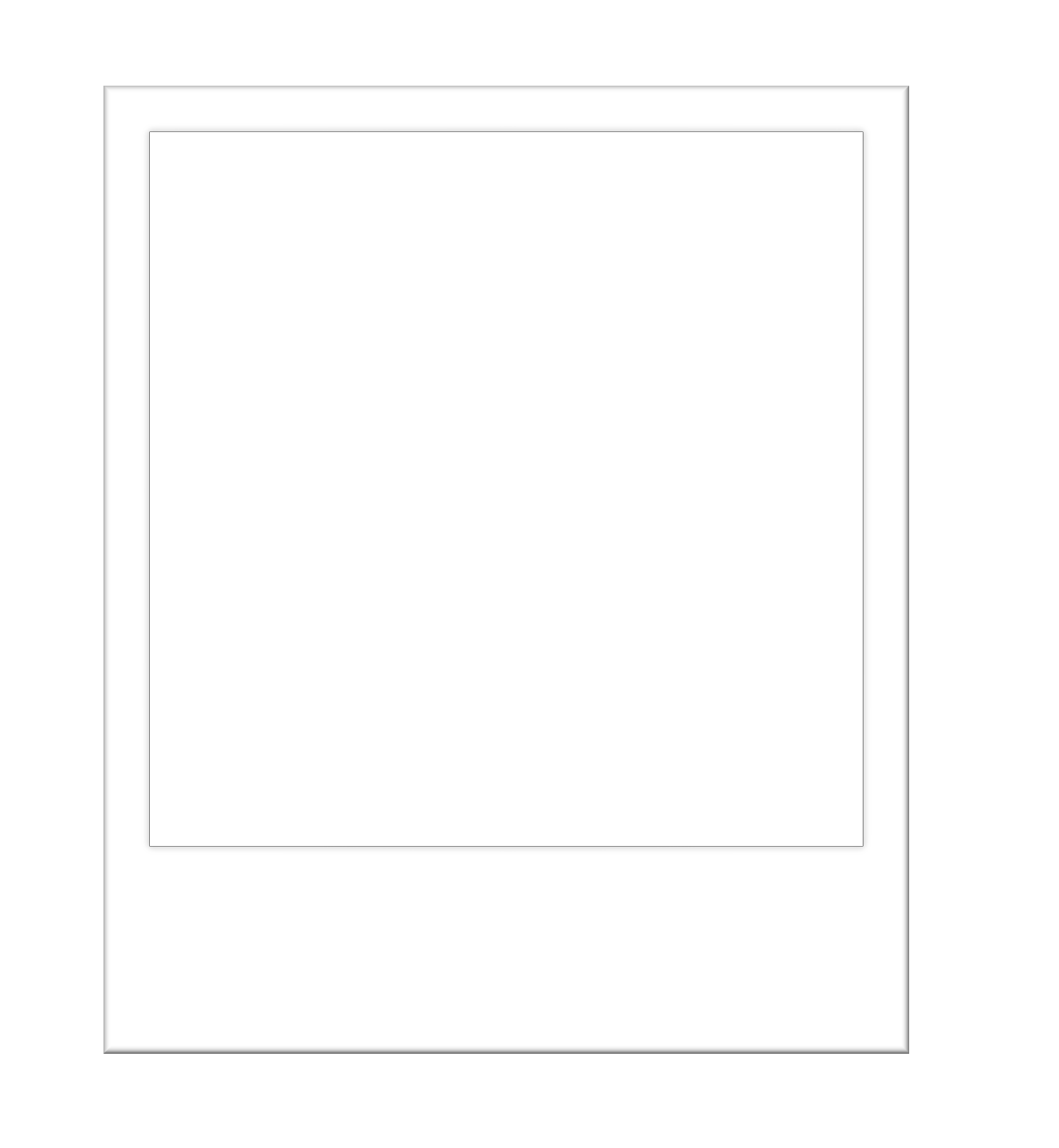




Copyright : Parc Culturel du Biterrois 2008-2012, tous droits réservés. |
| Présentation | | Activités | | Outils de découverte | | Images du patrimoine | | Parcs Culturels | | Infos pratiques |
Voie Domitienne:
le PCB a développé plusieurs campagnes de sondages et de fouilles, conduites dans le cadre de la DRAC Languedoc-Roussillon, qui ont porté sur des sites patrimoniaux majeurs du Biterrois sur le territoire des communes de Colombiers, Nissan-lez-Ensérune et Vendres.
Une piste protohistorique, chemin creux aménagé en terre battue et bordé d’un fossé, a pu être retrouvée à Colombiers.D’après le matériel mis au jour, conforme à celui des agglomérations voisines, il semble avoir fonctionné entre la mi-VIe et le Ier siècle avant notre ère et sa situation, entre les oppida de Béziers et d’Ensérune, permet de penser qu’il peut s’agir de la mythique voie héracléenne qu’évoquent les textes anciens.
La voie domitienne qui, à partir de la fin du IInd siècle a assuré les relations terrestres entre l’Italie et l’Espagne, a été exhumée (2006-2010) sur deux points distants de 2 kms, à Taragone et Saint-André (Nissan) et au pied du col du Malpas (Colombiers). Observations décisives puisqu’elles ont permis d’affirmer qu’un axe de circulation à vocation impériale, essentiel à la prise de contrôle de la région, était implanté tôt au sud de l’étang pour relier au plus court Narbonne et Béziers, en desservant Ensérune. La voie consulaire, dans son premier état, reprend là très exactement, au lendemain même de la conquête romaine, le tracé et l’orientation du chemin protohistorique auquel, nous avons pu le vérifier, , comme à Béziers, elle se superpose ici exactement dans ce passage difficile en terrain humide et inondable.
Pour assurer la continuité du trafic et mettre la voie hors d’eau, un aménagement en remblai s’est imposé à partir des années 60 avant notre ère, à Nissan (Taragone) comme à Colombiers où un nouveau tracé, décalé de quelques mètres vers le Sud, marque la véritable construction de la voie tardo-républicaine, qui domine le paysage de près d’1 mètre.
Mais les fortes contraintes environnementales ont imposé de plus hautes exigences techniques qui ont conduit, un siècle et demi plus tard environ, les pontonniers romains à renforcer encore le dispositif en surélevant la voie d’un bon mètre lors de l’élargissement de l’emprise viaire assurant la monumentalisation de la voie vers les années 80 du Ier siècle de notre ère.
A Colombiers, l’emprise totale, évaluée à quelque 11-12 m, et la largeur de la chaussée, mesurée à 6,20 m, sont désormais considérablement augmentées et la fouille a permis d’identifier, en outre, sur son côté Sud, une couche sableuse interprétée comme une contrescarpe, sur laquelle a été installé le mur bordier de la nouvelle chaussée, et sur le côté Nord un espace de circulation. Le nouvel équipement viaire comprend alors trois éléments structurels :
- une chaussée principale bordée par un mur bien appareillé au Sud et dont la bande de roulement est constituée d’un mélange compacté de terre, de gravier fin, de mortier, d’une haute résistance, comme il est d’usage en milieu rural.
- une allée cavalière (5,50 m environ) au Nord, destinée à la circulation des piétons, des cavaliers et des troupeaux, équipée d’un revêtement souple et très perméable qui contribuait aussi à assurer un bon écoulement des eaux de surface.
-- un vaste espace aménagé, au sol souple, qui a pu être dévolu soit au croisement soit au stationnement des véhicules.
Ce réaménagement de grande ampleur, qui monumentalise ce segment de voie et double l’espace de circulation, a dû intervenir entre le premier et le troisième quart du Ier siècle de notre ère, fourchette parfaitement synchrone avec l’ampleur nouvelle du troisième état de la voie à la sortie de Béziers vers Cessero/ Saint-Thibéry.
Cliquez au centre de l'image pour ouvrir un diaporama pleine page
MEMO :
Nous organisons régulièrement des conférences et rencontres pour faire état de l'avancée de nos recherches archéologiques.
Informez-vous de notre actualité en cliquant ici ou contactez-nous pour demander à recevoir les dates de nos rendez-vous dans votre boîte électronique.
Consultez la rubrique "Itinéraire voie Domitienne : dans les pas des Romains".
Au bord de la Méditerranée, paysages d'eau, de terre, de pierre
